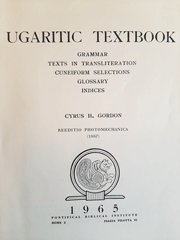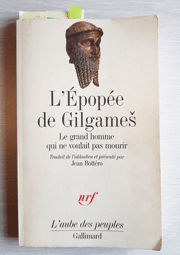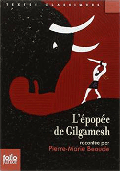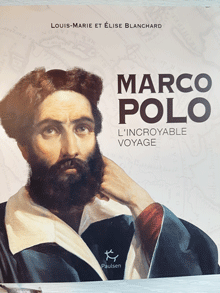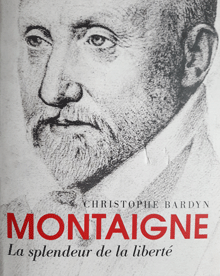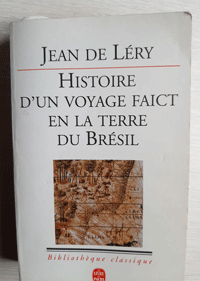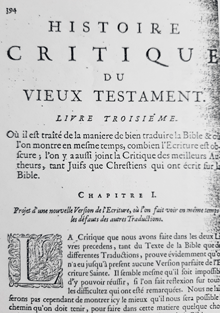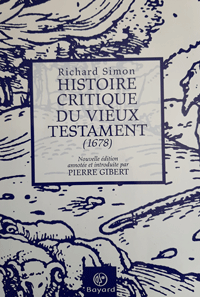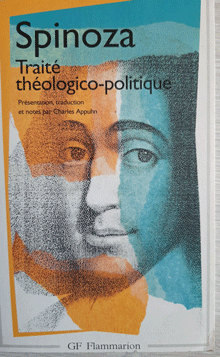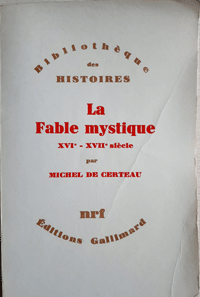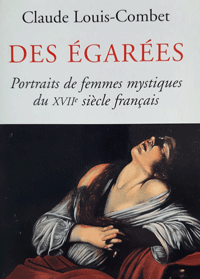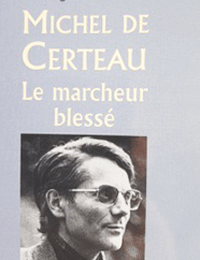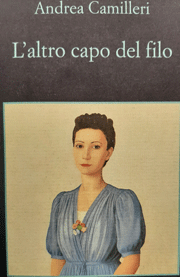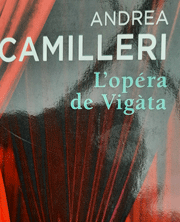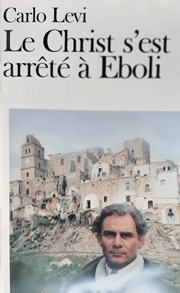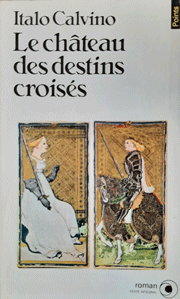flânerie dans ma bibliothèque
Fléchage du parcours : présentation générale, recherche, tirés-à-part et manuscrits, cahier par temps de guerre de ma mère, le thème du voyage, Marco Polo, les grandes découvertes de la Renaissance, le voyage au Brésil de Jean de Léry, le journal d’un négrier du XVIIIe s., la critique des textes sacrés par les Humanistes et les Critiques du XVIIe s., le voyage intérieur des « mystiques » , mystique, poésie et silence, mes auteurs italiens, mes auteurs québécois, les albums de Jeunesse, les romans jeunesse, quelques préférés de littérature générale…
On me demande souvent comment est ma bibliothèque, ce qu’elle contient. Je vous invite donc à une petite flânerie virtuelle, ou du moins numérique, qui vous donnera une petite partie de la réponse, car bien sûr, je vais devoir faire des choix. En l’état actuel, ma bibliothèque se maintient autour de quatre mille ouvrages. Des livres auxquels je tiens, parce qu’ils m’ont formé, élevé.
Dans mon bureau, à l’étage, les livres de recherche sont très majoritaires, même si, depuis que je suis à la retraite, j’y glisse quelques poésies et romans préférés (par exemple Julien Gracq, découvert à 17 ans). Les instruments de travail sont nombreux : grammaires et dictionnaires de langues anciennes, araméen, hébreu, ougaritique, grec, latin. Textes bibliques en langues anciennes et modernes. J’ai une belle concordance ancienne, avec reliure de cuir et pages aux tranches dorées, une très jolie bible hébraïque dans une couverture de cuir travaillé. J’ai acheté il y a quelques années déjà une grammaire égyptienne et un livre d’exercices. Je ne connaissais pas la langue des hiéroglyphes, alors je me suis pris au jeu, histoire de comprendre un peu le fonctionnement de cette langue si visuelle. Je dois avouer que cela n’a été qu’un jeu d’amateur et que j’en connais toujours bien peu !
recherche
Pour un chercheur, il importe d’abord de réunir les éditions critiques des textes, puis les grands commentaires de la discipline, pour moi donc juifs, chrétiens. Ils occupent toute la place, je les sens dans mon dos quand je suis à l’ordinateur. Gardiens muets, bienveillants, tandis que j’écris mes propres livres. Quand je rédige un ouvrage de spécialité, ils se glissent dans les notes de bas de page. Si j’écris des romans, alors ils trouvent une autre façon de s’introduire dans mon écriture, par ce phénomène qu’on appelle intertextualité. Tous les mots que j’écris se trouvent déjà dans les livres qui m’entourent. Simplement, je ne les agence pas dans le même ordre ; ils deviennent alors, par mon énonciation propre, une authentique création. C’est le terreau de mes pensées.
Je dois, bien sûr, ajouter au terreau les étagères consacrées à la linguistique, aux sciences du discours et aux théories littéraires. J’ai eu la chance d’étudier au moment où la sémiologie, en particulier en France, brillait d’un particulier éclat, et j’ai beaucoup appris de R. Barthes, J. Kristeva, T. Todorov, M. Bakhtine, pour ne citer que quelques noms, sans oublier les revues Pratiques (Celted, A. Petitjean, université de Lorraine) ou encore Sémiotique et Bible (Centre de Recherche CADIR, Lyon).

Bien sûr, les livres ont migré hors de mon bureau. Ils sont chez eux à tous les niveaux. Dans les pièces annexes, j’ai classé les sciences humaines – histoire, sociologie et psychologie, anthropologie, psychanalyse. Et aussi la philosophie générale, surtout l’antique eu égard à ma spécialité, et contemporaine, eu égard à mon temps.
Langues et cultures se mélangent sur les étagères, exception faite pour mes auteurs italiens favoris, pour lesquels j’ai réservé quelques étagères. Dante, Calvino, Buzzati, M. Messina, Tabucchi, Quasimodo, Pavese, De Luca, M. Agus, Eco, Camilleri, Vitali, Baricco m’en savent gré. Ils me le disent chaque fois que je les ouvre…
tirés-à-part et manuscrits
En parcourant les étagères, je vois que les rangées de livres sont rythmées par un grand nombre de tirés-à-part, offerts par les écrivains amis, les collègues, les chercheurs rencontrés dans les congrès. Ce sont des sources précieuses. On comprend tellement mieux quand on connaît l’auteur. Il y a aussi quelques manuscrits, que je conserve précieusement. Parmi eux, un journal écrit par ma mère durant une partie de la guerre de 1939-45. Elle rédigeait quand elle le pouvait, laissant de longs moments de silence dus aux soucis quotidiens qui prenaient tout son temps de mère de quatre puis six enfants traversant une période chaotique. La page ici reproduite est datée de Pâques 1943.
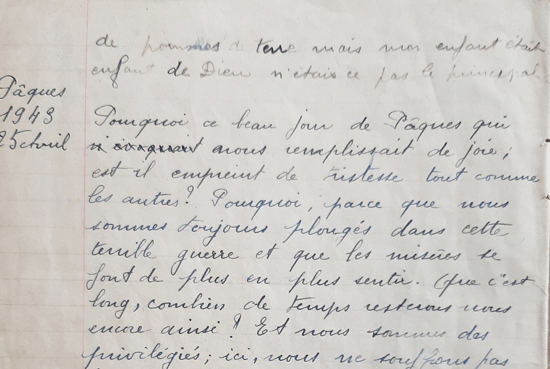
Le voyage
A travers toutes les disciplines et tous les genres, la thématique du voyage est récurrente. Elle est déjà présente dans mes rayons Proche-Orient Ancien avec l’Épopée de Gilgamesh et le voyage de l’autre côté de la mer, en quête de la vie sans la mort. Dans l’Antiquité grecque, l’Odyssée, et bien sûr les récits du grand voyageur que fut Hérodote. De Xénophon et son Anabase, je n’ai pas gardé un bon souvenir ; elle exaspéra souvent ma patience quand je faisais mes versions grecques au lycée.
J’aime le livre synthèse de Lionel Casson, Travel in the Ancient World, rempli de références utiles sur les voyages par terre, par mer, sur leurs dangers. Les naufrages étaient fréquents, les attaques de brigands également. Flavius Josèphe, auteur juif romain, raconte un naufrage dont il réchappe. Et le Nouveau Testament a gardé le récit d’un naufrage de Paul de Tarse qui dit en avoir fait trois ! Finalement, pour voyager, le mieux était de faire comme Cicéron qui se faisait construire une villa aux endroits où il faisait étape en partant de Rome. Une villa après chaque journée de voyage ! De l’art d’être partout chez soi !
On repère vite combien, dans le poème de Senghor ci-contre, le voyage possède sa face intérieure. Je regrette, à ce sujet, la presque totale absence de l’Extrême Orient dans ma bibliothèque. Quelques livres de sagesse ne comblent pas l’absence des grands textes bouddhiques, shintoïstes, hindous, qui m’instruiraient sur les voyages extérieurs autant que sur les intérieurs. Mes études orientées vers un autre champ ne m’ont pas laissé le temps de fréquenter les textes majeurs. Et la vie passe si vite ! Pour ce secteur qui fait défaut, je recours à Internet, mais j’ai aussi quelques amis qui m’alimentent en textes de sagesse. Récemment, l’Art de bien vieillir dans l'esprit du Tao, chez Albin Michel, une anthologie sur les sages taoïstes.
Le temps des grandes découvertes.
Je possède, en revanche, une bonne collection des voyages par mer et par terre à l’aube de la modernité. Et tout d’abord, le précurseur, Marco Polo (né en 1254). À partir du livre qui lui est attribué, écrit par un certain Rustichello, assez ennuyeux, j’ai fait une adaptation romanesque : Le livre des merveilles de Marco Polo, Gallimard-J.Traductions et adaptations
Ce travail m’a permis de me doter de beaux livres sur Venise, son arsenal où se construisaient les bateaux qui parcouraient toutes les mers, d’Atlas correspondant à l’époque et d’études sur le personnage de Marco. Christophe Colomb est ensuite le premier d’une longue liste de livres qui ouvre sur l’aspect géographique, sur l’histoire et l’ethnologie de la conquête du Nouveau Monde.

J’ai un faible pour le livre célèbre de Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil (LGF 1994). Cet ouvrage, qualifié de « bréviaire de l’ethnologue » par C. Lévi-Strauss, étudié par Frank Lestringant et aussi Michel de Certeau, est un fabuleux exemple de la façon dont un européen du XVIe siècle, fuyant les guerres de religion, cherche à décrypter les caractéristiques de l’ « autre », l’indien rencontré en terre de Brésil. Mythes, religion, nourriture, anthropophagie, nudité et vêtement, écriture et oralité, il y a beaucoup de mystères à explorer pour Léry, ami de Calvin, parti de France vers Genève puis de Genève vers le Brésil pour rejoindre une colonie française et fonder un « Refuge » calviniste. Il y a dans ce récit beaucoup de comparaisons entre le vieux monde de la France et le nouveau monde des sauvages américains. Léry abhorre, bien sûr, l’anthropophagie. Mais en même temps, il ne peut pas ne pas faire la comparaison avec les atrocités faites en France au temps des guerres de religion. Dans ma bibliothèque, Léry n’est pas très loin de Montaigne et de Rabelais, tous gens ayant souffert des terribles guerres de religion (livre sur Montaigne, ci-contre, Flammarion).
Dans ces rayons assez fournis, j’ai réuni Las Casas, le grand défenseur des Indiens, Todorov et sa conquête de l’Amérique, Le Clézio, la relation de Michoacan, Lestringant, Jean de Léry ou l’invention du sauvage, et bien sûr bon nombre d’ouvrages de C. Lévi-Strauss. Je voudrais signaler juste un livre impressionnant, un peu plus tardif : Capitaine William Snelgrave, Journal d’un négrier au XVIIIe siècle, Gallimard, 2008. C’est Pierre Gibert qui retrouva un exemplaire traduit en français dans la bibliothèque du château de Tocqueville, dans le Val-de-Saire, Manche (à six kilomètres de l’endroit où je suis né…) Le capitaine Snelgrave, sujet de sa Majesté, justifie pleinement la traite des noirs, capturés en Guinée et transportés dans les Antilles. Il apporte des arguments, réfute les objections qu’on lui a faites contre la pratique de l’esclavage, le tout dans une langue raisonnée et bien tournée. Voir en lien les arguments avancés par le négrier. Ce journal, édité par les soins de P. Gibert, s.j., qui en a fait la longue préface et les notes, est un témoignage sur la traite des noirs d’une très grande valeur.
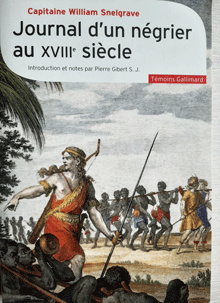
extrait du journal : Journal d’un négrier au XVIIIe siècle.pdf
La Critique des textes sacrés
Plusieurs rayons de mes étagères, correspondant toujours aux XVIe et XVIIe siècles, sont pris par l’histoire des idées et des croyances. On sait que les Humanistes se livrèrent à un travail gigantesque d’édition critique des textes anciens, profanes ou sacrés. Ils s’éloignaient du Moyen-Age en apportant d’autres instruments de lecture que ceux des théologiens scolastiques, férus des catégories d’Aristote, dont l’univers se fissurait dès le XVe siècle. Érasme, le plus célèbre des humanistes, voyagea à travers toute l’Europe, écrivit, dit-on, son Éloge de la folie, en cheminant sur sa mule vers l’Angleterre. Lui et ses amis ne connaissaient pas les frontières, ils créaient un monde des savants, travaillaient à éditer les textes anciens, sacrés et profanes, avec une boulimie incroyable. Ils furent les pères de la critique des textes religieux dans toute l’Europe.
Après les Humanistes, virent les Critiques dont l’un des plus connus est Richard Simon, qui ajoutait le mot « critique » au titre de la plupart de ses livres qui touchaient à la Bible. L’Histoire Critique du Vieux Testament (1678) est un phare dans l’histoire de la lecture critique de la Bible. Le mouvement humaniste suivi de celui des « critiques » eut un impact considérable sur la façon de regarder les textes chrétiens, qu’on pouvait critiquer comme on le faisait pour la guerre des Gaules de Jules César ou l’œuvre du philosophe stoïcien Sénèque. L’occident a derrière lui plus de cinq siècles de critique textuelle, historique et littéraire des textes sacrés. C’est une richesse humaine immense, qui ne rend d’ailleurs pas plus aisée la discussion avec d’autres socio-cultures de nos jours.
Et puisqu’il s’agit d’une flânerie dans ma bibliothèque, arrêtons-nous un peu et parlons de Richard Simon. Né à Dieppe, en 1638, il devint prêtre de l’Oratoire de France avant d’en être renvoyé après la condamnation de son livre majeur, Histoire Critique du Vieux Testament, 1678. Simon se situait dans la continuité de cet immense champ ouvert avant lui par les Humanistes tels que Érasme. Le mot « critique » voulait dire qu’on n’appliquait pas aux livres sacrés ce qu’en disait la tradition, mais qu’on cherchait à l’intérieur du texte lui-même les traces révélant sa composition, ses sources, les endroits et les milieux sociaux qui l’avaient vu naître. Un simple exemple : les traditions juives et chrétiennes disaient que Moïse était l’auteur des cinq premiers livres de la Bible. Ce savoir était inaliénable et Moïse était le personnage indépassable de la Loi et de tout l’Ancien Testament. Or quand on lit de près ces livres, on relève des redites, voire des contradictions. On voit donc bien qu’un seul homme n’a pas écrit ces livres, mais que plusieurs traditions y ont été rassemblées. Le savoir critique de Simon contredit donc le savoir de Tradition, tout comme ce fut le cas pour Spinoza, à peu près à la même époque. Son livre n’était pas encore sorti de chez l’imprimeur que déjà Bossuet en avait lu quelques bonnes feuilles. Bossuet, bien en cour près de Louis XIV, fit détruire le livre par le lieutenant de police du roi. Voici un extrait de l’arrêt pris par le Conseil du roi, le 19 juin 1678 : « Sa Majesté considérant combien il serait de pernicieuse conséquence que ce livre fût donné au public (…) a ordonné et ordonne que tous les exemplaires du livre intitulé Histoire critique du Vieux Testament seront supprimés ; fait défense à tous imprimeurs, libraires et tous autres de le faire ci-après réimprimer, vendre ni débiter, même sous prétexte de changement de titre… » Fin juillet, les exemplaires du livre sont brûlés, sauf quelques exemplaires qui échappent au désastre. Il sera réimprimé hors du Royaume de France et échappera ainsi à la censure, à Rotterdam, deux ans après. Aujourd’hui, Richard Simon fait figure de fondateur de la critique biblique. Mais il faut bien sûr se rappeler combien il a reçu des Humanistes qui avaient initié l’étude critique des textes sacrés. Dans son Traité théologico-philosophique, 1670, ci-contre, Spinoza s’en prend aux préjugés des théologiens. Il affirme que Moïse n’est pas l’auteur des cinq premiers livres de la Bible. Simon le cite et le critique, car il y a grand danger à louanger un philosophe juif attaqué par beaucoup comme athée, et expulsé de la Synagogue. En fait, Simon n’était pas philosophe. Mais il lisait les commentaires juifs, par exemple les Midrachim.
Voyages intérieurs.
Mes étagères comprennent donc beaucoup de livres « sérieux » comme c’est le cas pour tous les universitaires ! J’y ajoute un secteur d’ouvrages qui traitent tous de « voyages intérieurs » aux XVIe et XVIIe siècles. Il s’agit des « mystiques ». Inutile de dire que je n’ai aucune compétence universitaire pour ce secteur. S’il a pris une jolie place sur mes étagères, c’est que l’intérêt m’en est m’est venu par mes rencontres avec deux spécialistes de la question. Le premier, par ordre d’apparition dans mon existence, est mon frère, Joseph, chercheur au CNRS, décédé en 2015. Le second est Michel de Certeau, décédé en 1986, dont j’ai fréquenté un groupe organisé autour de lui, dans les années 70. Ses livres, la fable mystique, la faiblesse de croire, l’écriture de l’histoire, l’invention du quotidien, la culture au pluriel… ont pris de plus en plus de place, à côté de ceux de mon frère et d’autres spécialistes.
Les plus célèbres mystiques sont sans conteste les espagnols Jean de la Croix et Thérèse d’Avila, que je connais très mal, mais la France vit se développer ce courant de façon très florissante. J’ai appris à ne pas confondre « mystique » avec les mouvements qu’on voit fleurir de nos jours, mouvements américains d’enthousiasme spirituel, mouvements tout aussi enthousiastes des évangéliques et des charismatiques un peu partout sur la planète, en particulier en Afrique. Joseph Beaude a écrit quelque part que la mystique est « irréligieuse ». Entendons par là qu’elle entend se passer de tous les moyens que les religions mettent à la disposition des fidèles, rassemblements liturgiques, textes dogmatiques, hiérarchie ecclésiastique, etc. Les mystiques de cette époque, où les femmes furent très présentes, sont des personnages errants, partis sur un voyage tout intérieur puisqu’ils passent souvent leur vie sans jamais franchir la clôture de leur couvent. Les mystiques ont un côté déviant, ce ne sont pas des super-saints. Voyage intérieur, à la recherche d’un divin enténébré de toutes parts, « caligineux » comme ont dit à l’époque, côtoyant des abîmes psychologiques insondables et parfois terrifiants. Exception faite pour quelques grands noms qui fréquentaient les cours des rois, il y eut beaucoup de petits et de silencieux, femmes et hommes du peuple sans culture, qui prirent, souvent à leur corps défendant, les chemins aventureux de la mystique. Croyants, incroyants ? Ils ressemblent, a écrit M. de Certeau, au personnage de Mickey interdit à la fois sur le territoire des États-Unis et le territoire mexicain, traduisons : malvenus dans le domaine des croyants et dans celui des incroyants. Leur vie se passe à longer une frontière séparant croyance et incroyance, sans jamais pouvoir décider à quel côté ils appartiennent et où ils se sentent le mieux.
Aujourd’hui où les institutions chrétiennes, surtout catholiques, s’effondrent à une vitesse exponentielle, la place existe sans doute pour des écritures personnelles, individuelles, singulières jouant en écho avec la mystique de jadis, quoi que les conditions soient très différentes. Ces écritures se situent dans les marges de la religion à qui elles ne doivent pas grand-chose, comme l’écrit B. Sarrazin qui parle, sans chercher à être discourtois, de « bazar mystique » (Le rire et la mort de Dieu, Bayard, 2020, p. 241). Disons qu’il existe des recherches singulières, personnelles, parfois vintage ou retro, mais plus souvent intemporelles, qui ne font pas grand bruit mais construisent leurs auteurs, et ne se revendiquent absolument pas d’une appartenance confessionnelle. Dans les années 70, M. de Certeau expliquait que la religion chrétienne s’était folklorisée et que de ce fait, son langage était à la disposition de tous ceux qui décidaient de le réemployer, loin de toute institution, sans contrainte (M. de Certeau, J.-M. Domenach, Le christianisme éclaté, Seuil). Je reçois assez régulièrement des poèmes, des essais, tous manuscrits qui ont bien peu de chances, pour ne pas dire aucune, de percer chez un éditeur connu. Ils illustrent assez bien les propos de Certeau. On reprend du vocabulaire religieux, on le tresse avec le vocabulaire plus profane, on trace ainsi un chemin créatif loin des dogmatismes et des idéologies religieuses. Je garde dans ma bibliothèque un manuscrit de poèmes dont l’auteure, B. Billa, a revisité le très ancien genre littéraire des psaumes. On se dit qu’on a déjà vu ce langage, on se dit sans doute qu’il y a longtemps qu’on s’en est détourné, que tout cela sent le déjà lu. Mais à lire ces courts poèmes, on découvre que les champs lexicaux bibliques sont ici subvertis par d’autres champs pour produire des musiques nouvelles, singulières, qui dépassent le monde cloisonné et délimité des religions instituées. Le poème mis en exergue par l’auteure vient du poète soufi Ibn Arabî, un grand mystique musulman du Moyen-Age. On est ainsi averti que tout le recueil invite dans un monde qui dépasse le bien-pensant religieux qui pourtant affleure encore. On y peut lire alors que Dieu est « Christ et Bouddha », qu’il est « un ours affamé, une gazelle dévorée, et ni l’un ni l’autre » , que « si j’étais Dieu, je vivrais sous psychotropes, consumé par le feu de solitude » et que « si j’étais Dieue, je serais trouée de partout, clouée au pilori de vos ignominies ». La Bible présente les psaumes comme l’œuvre d’hommes tel le roi David. Ici, une femme produit ses psaumes à elle.
Cette réécriture qui recycle à sa façon un lexique biblique me conduit vers une autre étagère où j’ai rassemblé des livres sur le rire et le discours biblique. On dit souvent que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Cela ne signifie pas qu’il est le plus lu. Qui lit vraiment ce livre ? Les spécialistes universitaires, les « fidèles » qui les écoutent par petits morceaux dans leurs rencontres. Une réelle connaissance de la Bible se fait par son appropriation culturelle : arts tels que peinture, musique, littérature. À noter que cette appropriation est souvent parodique, manie l’humour, parfois le sarcasme, souvent la drôlerie. Ainsi Alfred Jarry compare-t-il la montée de Jésus au calvaire à une couse cyclise (A. Jarry, Passion considérée comme course de côte, Le canard sauvage, 1903. Voir Sarrazin, le rire et la mort de Dieu, p. 213). Qu’on pense à la littérature carnavalesque du Moyen-Age, aux chansons estudiantines, ou encore à Rabelais et à son personnage, frère Jean des Entommeures, grand buveur et grand massacreur de voleurs de raisins de son monastère, plus prompt à défendre le « culte du vin » que le « culte divin ». J’ai naguère organisé un colloque universitaire sur le sujet, publié sous le titre Le discours religieux, son sérieux, sa parodie… (Université de Metz/Cerf 2001). Et je renvoie pour finir sur ce thème, aux livres de Bernard Sarrazin, La Bible parodié (Cerf), Le rire et le sacré (DDB) et récemment Le rire et la mort de Dieu, Bayard, 2020).
Mes auteurs italiens
Mes premiers contacts avec la littérature italienne remontent à mes années d’étudiant. Je fréquentais le Goethe Istitut de Rome pour y apprendre l’allemand. Les autres étudiants venaient d’un peu partout, et en particulier... d’Italie. J’ai fait mes premières lectures sur leurs conseils, et j’ai gardé de ce temps déjà lointain quelques fidèles amis et quelques livres, dont Leopardi, Quasimodo, Pavese. Je n’oublie pas le célèbre roman du XIXe siècle, I promessi sposi, de A. Manzoni, conseillé pour enrichir son vocabulaire quand on commence l’italien. J’ai aussi souvenir d’être allé au théâtre écouter G. Ungaretti réciter ses poèmes : « Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata... »
Peu à peu, j’ai élargi mon champ de lecture, sans jamais devenir un grand connaisseur. J’apprécie surtout les auteurs qui ressemblent peu aux français. Dans la ligne de l’humour folklorique, genre Le petit monde de Don Camillo, de Guareschi (1948), je lis très volontiers Andrea Vitali. Ce médecin de Côme fait des livres drolatiques, d’un humour délicat, avec des personnages très attachants. Je pense à Almeno il cappello (traduit en français sous un autre titre). Le personnage principal cherche à créer non une simple fanfare, mais quelque chose de plus ambitieux, genre orchestre. Tout se passe sous Mussolini et les quiproquos ne manquent pas. Un délice. Dans le même genre, moins ample, La modista (traduit en français : La modiste) raconte les aventures des personnels de la mairie et des carabiniers autour du magasin de la modiste et de sa tenancière.
Dans les années 70, la lecture de Cristo si è fermato a Eboli (1945) (Le Christ s’est arrêté à Eboli) de Carlo Levi m’a bouleversé. L’auteur, médecin et politique piémontais, peintre, raconte son exil dans des terres insalubres de la Basilicate. Exil voulu par le régime fasciste qui confinait ses opposants politiques. Carlo Levi se retrouva dans les villages miséreux des confins, Grasssano, puis Aliano. Il avait l’interdiction d’y exercer son métier de médecin, que d’ailleurs il n’exerça jamais (sauf pour soigner le fils du maire et un fils de paysan), faisant le choix de la peinture. On a là un document ethnologique de grande qualité sur la population du Mezzogiorno. Vous avez sans doute vu le film qui en a été tiré, avec Gian Maria Volonte dans le rôle principal. Mais le livre en apprend beaucoup plus. J’ai rangé Levi à côté de deux autres publications aux aspects ethnologiques assez semblables : le premier est Les derniers rois de Thulé, de Jean Malaurie, consacré aux Inuit de la côte nord-ouest du Groenland (j’ai retrouvé les villages dont parle Malaurie lors d’un voyage là-bas) ; le second est La ferme africaine, de Karen Blixen, dont on a tiré le film Out of Africa. Un document saisissant sur le Kenya colonial.
Parmi les classiques, en italien ou en traduction, je repère, sur mes étagères, et sans trop de classement, Dante, La divine comédie, Maria Messina, Personcine, Mario Rigoni Stern, Le sergent dans la neige, Antonio Tabucchi, Le fil de l’horizon, Pereira prétend, Dino Buzzatti, Le désert des Tartares (1940), la sarde Milena Agus, Mal de pierres, La comtesse de Ricotta, Nicolo’ Ammaniti, io e te, Alessandro Baricco, Soie (Seta), Châteaux de la colère, Novecento, La sposa giovane, Smith et Wesson, etc.Voilà, pour le cas où vous soyez en recherche de belles lectures estivales.
Mes Calvino occupent une place importante. Cet auteur a multiplié les genres, les thèmes, avec toujours une sorte de décalage du réel en incipit de façon à mieux comprendre ce réel (comme a écrit Baricco pour ses propres ouvrages). Un vicomte qui laisse la moitié de son corps sur le champ de bataille, un enfant qui ne veut plus descendre de ses arbres, un chevalier qui n’existe pas et qu’on localise à sa seule armure, un ouvrier de l’énigmatique entreprise « SBAV », portant un nom de chevalier, Marcovaldo, qui se comporte en poète maladroit dans la ville, etc. etc. Quand je lis certains auteurs italiens, je mesure combien l’influence de Calvino fut importante sur ses successeurs. Je pense en particulier à A. Baricco, auteur aux aspects surréalistes, humoristiques et dérisoires, avec cette locomotive qui n’attend plus que quelques kilomètres de rail pour rouler, ou cette étrange « jeune épouse » débarquant à l’improviste dans une famille particulièrement improbable. Baricco n’oublie pas ses études musicales qui donnent un style et une organisation à ses livres. C’est un auteur qui aime la vie, la chante en nous déroutant pour mieux nous inviter à l’aimer.
De Umberto Eco, je possède à la fois les livres de sémiologie littéraire (L’œuvre ouverte, Lector in fabula...) et les romans ou nouvelles (Comment voyager avec un saumon, le pendule de Foucault, le nom de la rose). C’est un auteur puissant, compulsif, comme je n’en connais pas d’équivalent en France.
Je fréquente régulièrement Erri de Luca, tant pour ses livres sur la Bible que pour son œuvre de fiction. Cet écrivain situé à gauche, à l’écriture concise, plus anthropo-sociologique que psychologique, fait une oeuvre singulière. Certains de ses livres, comme Impossibile (2020. Traduit en français) sont d’une grande densité, autour de ses thèmes favoris : le temps des brigades rouges et l’amour de la montagne. Livre puissant.
Je possède un bon rayon de polars, appelés « gialli » en italien, à cause de la couleur habituelle des romans policiers. J’ai une bonne vingtaine de Andrea Camilleri, le sicilien des éditions Sellerio de Palerme, connu en France pour le personnage du commissaire Montalbano. Si vous n’avez jamais lu cet auteur, je vous conseillerais volontiers La concession du téléphone, sorti en Poche, comme bel exemple de comique autour du fonctionnement de l’administration italienne. Un négociant en bois veut faire poser une ligne téléphonique. Le livre est fait des lettres du brave négociant et des réponses du préfet de région et de l’administration. J’aime aussi les auteurs de policiers attachés à une région précise, Bari et les Pouilles, par exemple pour Carofiglio, de Gênes et la Ligurie pour Bruno Morchio et les enquêtes de son détective Bacci Pagano.
Je n’ai pas parlé du succès phénoménal de l’amie prodigieuse, de Elena Ferrante, ni, de la même autrice, La vie mensongère des adultes. Mais j’aurais encore tant à dire...