Italie
Je découvre vraiment l’Italie la seconde année d’un séjour d’études (1966-1970) en m’inscrivant au Goethe Institut de Rome, où je suis les cours avec des Italiens. Quand arrive mon tour, je traduis le texte allemand en italien. Salutaire exercice pour apprendre deux grammaires à la fois. Mon voisin sourit parfois, non parce que j’ai mal compris l’allemand mais parce que j’ai fait une faute en italien, qu’il s’empresse de me signaler.
N’étant pas d’une famille bilingue, comme c’est aujourd’hui chose assez fréquente, j’ai la conscience claire d’avoir une langue-mère. Cela me fait penser à Hannah Arendt, cette intellectuelle juive émigrée aux États-Unis à cause du nazisme, qui avait un sens très fort de ce qu’est la langue-mère. Die Muttersprache ! Son allemand était resté en elle, plus fondamental que tout, avec les chansons et les poèmes que lui transmettait sa mère. Arendt pensait que dans le désastre du national-socialisme, la langue seule était restée. Les barbares l’avaient dénaturée, affolée, en déviant des mots, en les manipulant. Mais elle avait résisté. Cette langue, Arendt la portait dans sa conscience, depuis toujours.

Le français, je le porte en moi depuis toujours. J'aime à penser qu'une grande partie de mon identité passe par la langue héritée de ma famille et que je personnalise en la pratiquant. Elle m’impose, par contrecoup, la difficulté à entrer dans une langue « étrangère ». Quand on surmonte la difficulté, la pratique de l’autre langue devient la chance de sa vie. Elle apporte un second monde, et met dans « la meilleure des conditions humaines », comme dit Barbara Cassin à propos de Arendt.
Durant ces années étudiantes, nous allons au théâtre voir du Pirandello, ou écouter Ungaretti réciter ses poèmes. C’est le temps du grand cinéma italien, Fellini, Visconti, Leone, Pasolini que j’apprends à découvrir en même temps que la nouvelle vague francophone qui s’affiche dans un cinéma d’art et essai : Godard, Truffaut, Lelouch. Sur la RAI, les interminables émissions de variétés, sirupeuses, marient les styles dans une sorte de grande kermesse sentimentale : on passe du bel canto aux chansons napolitaines, des chanteurs de charme aux voix éraillées des latin lovers. Au milieu de tout ce fatras, émergent de vraies perles. Je découvre Luigi Tenco le passionné, qui se suicide au festival de San Remo, en 1970, parce qu’on n’a pas retenu sa chanson pour la finale. Quarante-cinq ans après, je murmure certaines de ses chansons (Se potessi, Angela…) En 1970, je découvre le premier disque de Fabrizio de Andrè, et la chanson Preghiera in Gennaio, consacrée à Tenco qui a préféré la mort à la bêtise du public. Tenco n’a pas envisagé qu’un suicide ne pousse pas les imbéciles à réfléchir. Sauf miracle, un imbécile le reste toute sa vie. Fabrizio de Andrè ne se suicidera pas ; la bêtise, il la combat dans une voie volontiers anarchiste. Mais son talent explose dans toutes les directions, la chanson engagée, qui peut prendre des accents surréalistes, la poésie pure, l’humour, le folklore. Il puise dans d’autres langues-mères : le sarde et le ligure. Il adapte des textes étrangers (Spoon river, de E. L. Masters, dans No al denaro, no all’amore né al cielo ; les évangiles apocryphes dans La buona novella). Au rythme de la sortie de ses disques je découvre un « cantautore » (auteur-chanteur) qui admire Brassens et Leonard Cohen dont il a traduit des chansons. Il meurt en 1999, mais ne me quittera jamais plus, pas plus qu’il n’a quitté la mémoire de l’Italie où ses chansons sont devenues un vrai patrimoine (Bocca di Rosa, La canzone di Marinella…)
Je profite des vacances pour découvrir le pays. La Toscane, bien sûr, mais aussi Naples, Sorrento, Capri, Herculanum. Avec l’ami Rupprecht et mon frère Gérard, venu pour quelques jours, nous descendons à Naples, Pompéi, poussons jusqu’à Paestum. En juin 1970, fatigués par les examens universitaires, nous filons dans la 403 de Jean-Paul jusqu’au port de Naples où nous embarquons pour Palerme. Nous ferons le tour de la Sicile, et remonterons par Messine et la Calabre jusqu’à Rome. La Sicile est alors très peu défigurée par le tourisme. Longues plages, superbes côtes, petits restaurants et cuisine casalinga. Je découvre cette terre de contrastes. L’Etna crache ses fumées et ses bombes de lave et se couvre de neige l’hiver, une neige qui se couvre à son tour de cendre grise. La terre tremble ; elle vient de détruire la petite ville de Gibellina, non loin de Ségeste dont le temple résiste aux mouvements telluriques depuis des siècles. Les vestiges du passé sont partout. Carthaginois, Grecs, Romains, Arabes, Normands, ont laissé des merveilles. Temples et théâtres grecs, mosaïques romaines, systèmes d’irrigation, jardins et patios arabes, moulins à vent des marais salants près de Marsala (le « port d’Allah » aménagé par les Arabes, en face de la Tunisie), châteaux et églises arabo-normands, églises baroques du sud-est de l’île. J’ai voulu revoir la Sicile et j’y suis retourné récemment par deux fois. Les souvenirs avaient glissé, s’étaient mélangés, condensés selon des lois proches de celles que donne Freud pour les rêves. De tels glissements et de telles contractions ne sont pas pour me déplaire. Ils font du vécu une sorte de mythe fécond.
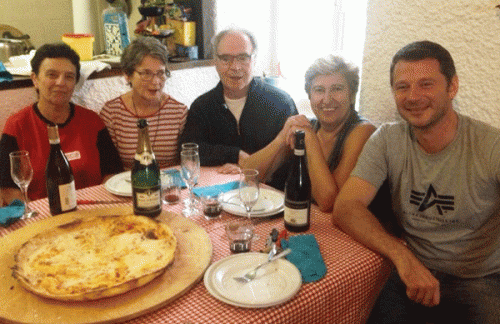
Casa della nonna, Santa Margherita Ligure. Qui, c'è sempre una focaccia da assaggiare. Mille grazie, Lucia.
Ces temps privilégiés de la vie étudiante ne sont pas à l’abri des secousses de la politique. Début juin 1967, nous arrive la nouvelle de la guerre entre Israël et ses voisins, qui prendra le nom de « guerre des six jours ». Nous sommes suspendus à nos radios pour les bulletins d’info. L’année suivante, en mai, la France explose. Impression d’être relégués en marge. Le courrier ne nous parvient plus. Le téléphone n’est pas encore dans nos habitudes ni dans nos moyens. Nous apprenons par bribes ce qui concerne nos familles, nos villes. L’Italie ne connaît pas cette explosion étudiante, qui a provoqué un si grand remuement. Mais de sombres mouvements sont à l’action, de façon moins concentrée mais tout aussi violente. Je garde le souvenir des attentats à la bombe des indépendantistes dans le Haut-Adige et le Trentino où je me rends en train pour des vacances. Les gares sont sous haute surveillance. Un autre extrémisme apparaît au grand jour en 1970 avec les Brigades Rouges qui vont marquer la vie italienne pour plusieurs années. Aldo Moro, chef de la Démocratie Chrétienne, est kidnappé en 1978, et retrouvé en plein cœur de Rome, dans le coffre d’une voiture. Petit souvenir personnel : je l’avais croisé peu de temps auparavant, sur un chemin de randonnée, dans les Dolomites.
Arrêtons-là ces souvenirs. Ils sont pour moi comme le temps fondateur de ma passion sans partage pour l’Italie. Il faudrait, pour comprendre cela, ajouter les amitiés nées alors, la joie de découvrir la langue, et les jours passés dans les familles amies. En fait, l’Italie vit en moi. Je m’en suis éloigné parfois, surtout pendant les années où j’ai fréquenté assidûment le Québec. Mais toujours je suis revenu.

Tutta quella città…non se ne vedeva la fine… La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine ? E il rumore su quella maledettissima scaletta… era molto bello tutto… e io ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone, e non avevo dubbi, era garantito che sarei sceso, non c’era problema, col mio cappello blu, primo gradino, secondo gradino, terzo gradino (…) Ma non c’era una fine. Quel che non vidi è dove finiva tutto quello.
A. Baricco, Novecento. Un monologo.
L'Etna














