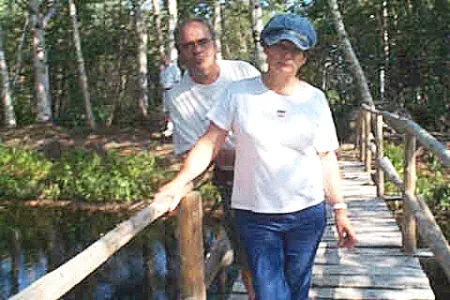Québec 1
J’ai commencé à fréquenter le Québec dans les années 90. Des échanges universitaires ont conduit à la mise en place de colloques, de séjours d’enseignement et de recherche de longue durée. Je m’y suis rendu également pour visiter le pays et les provinces voisines, l’Ontario et les Provinces maritimes. Si je mets bout à bout voyages et longs séjours, je compte plus d’une année de présence sur une terre qui m’est devenue de plus en plus familière, et où je compte de fidèles amis.
J’ai tant gardé de souvenirs que je serais bien en peine ranger par ordre d’importance les images qui me sont restées dans la tête, que ce soit les îles du Saint-Laurent comme l’île d’Orléans, à la porte de Québec, Grosse-île, qui fut l’endroit de quarantaine pour les émigrants venus d’Europe, le cap Tourmente et le tourbillon d’oies des neiges qui s’y arrêtent, vers octobre, le temps d’un été des Indiens, l’ambiance de Noël dans le Vieux Québec ou sur les places de Montréal, le carnaval de fin janvier - début février sur les plaines d’Abraham et sur le fleuve en glace, le traversier pour Lévis qui, l’hiver, peine à jouer son rôle et vous débarque sur l’autre rive figée par le froid extrême. Je n’oublie pas les balades en raquette dans le bois, par moins 40. J’ai aimé voir la Beauce, l’Estrie et Sherbrook sous les érables rouges et les premières neiges, Charlevoix et Petite-Rivière-Saint-François, chère au cœur de l’amie Micheline. Un de mes plus beaux voyages est le cabotage le long de la Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent. Le bateau vous conduit jusqu’à Blanc-Sablon, à la frontière du Québec et du Labrador, en face de la pointe Nord de Terre-Neuve. Une semaine de bateau aller et retour.
J’ai gardé des souvenirs très vifs de la faune marine, à Tadoussac, bien sûr, mais surtout en descendant le fleuve vers l’Océan, ou en partant de Percé pour découvrir, au large, la compagnie des dauphins joueurs et des baleines à bosse. Ce sont ces dernières que j’ai le plus souvent observées, au Canada, mais aussi au Groenland et au Svalbard. Il y a aussi l’île Bonaventure et sa colonie de fous de Bassan, chère à Anne Hébert.
L'hiver
J’ai connu le Québec aux quatre saisons, j’y ai passé de longues semaines d’hiver. On y découvre un pays tellement différent. Hiver comme été, les premières sensations sont qu’on n’y est pas à l’étroit. La forêt (le bois) n’est pas naturellement votre amie ; elle garde un aspect non domestiqué, sauvage. J’y ai observé des ours et des élans. La plupart des zones habitées se sont créées finalement auprès du Saint-Laurent et des rivières, en repoussant un peu plus loin la forêt. Forêt et rivières partout présentes dans les récits des européens arrivant aux XVIe et XVIIe siècles.
La neige arrive un peu plus tard qu’autrefois, me disent les amis. Réchauffement climatique ? Il arrive qu’elle se manifeste, en novembre, demeure quelques jours et reparte, avant de revenir s’installer pour de bon. En cette fin d’année 1999, fin octobre, nous la surprenons sur les arbres roux de l’Estrie, puis elle part, tardera quelque peu à revenir. Novembre est brumeux et triste. On se prend à désirer la neige. En décembre, elle est là, nous trouvons nos vêtements européens un peu légers, et l'on nous dit qu’on n’a rien vu encore en matière de grand froid. A Noël, nous quittons notre appartement de la rue Wilfrid-Laurier, face aux plaines d’Abraham, pour nous rendre à la cathédrale catholique. Elle nous paraît soudain très loin, le froid nous poigne. Nous entrons dans la première église illuminée, une église anglicane, où l’on nous accueille chaleureusement. Jamais adverbe n’est tombé plus juste. Nous ne sommes pas trop désorientés : les costumes, les enfants de chœur, la chorale, le rite nous rappellent notre enfance normande. Le lendemain, l'amie Micheline nous conduit dans un grand magasin pour acheter de vrais vêtements qui conviendront aux grands froids.
Vers fin décembre, la neige est bien installée, mais nous n’avons encore pas ressenti les grands froids. Nous n’avons pas pressenti non plus la tempête du siècle qui s’est abattue sur la France (nous sommes fin 1999). J’en prends connaissance un peu tard, par la TV. J’appelle mon voisin chargé de surveiller ma maison. La cheminée s’est écroulée en partie et a provoqué de gros trous dans le toit. Tout le monde est débordé. Mon toit est resté ainsi deux jours avant qu’un couvreur ne le bâche. A cinq mille kms de là, je fais ce que je peux, déclare le sinistre à mon assureur, en promettant plus de détails à mon retour, en… avril. Faute de trouver des tuiles, et surchargé de travail, le couvreur réparera en juillet, six mois après le sinistre.
Début janvier, à Québec, les grands froids sont arrivés. Trottoirs encombrés de glace. Toute la nuit, sonneries des engins de déneigement, nouvelles sensations. Du balcon, nous admirons les plaines d’Abraham où les gens ont sorti les skis. Les fleurs grises ont envahi les eaux du Saint-Laurent, puis se sont transformées en glace épaisse, hachée par les forts courants de l’endroit. Les traversiers peinent à se rendre sur la rive opposée. L’un d’eux s’est retrouvé à moitié perché sur une plaque et a dérivé jusqu’à la pointe de l’île d’Orléans. La statue de de Gaulle, non loin de notre immeuble, est impassible sous les vents violents qui soufflent des plaines. Nous tentons une promenade sur les plaines quasiment désertées et nous comprenons vite notre douleur. Le vent est terrible. Retraite accélérée vers l’appartement. On songe bien sûr à Gilles Vigneault : « mon pays, ce n’est pas un pays ».
Le carnaval de Québec se déroule de la fin janvier à la mi-février. Sculptures de glace, course de traîneaux à chiens dans la ville, sans oublier la traversée du Saint-Laurent en canoé, en plein milieu des glaces. Tomber à l'eau par ces températures n'est pas une petite péripétie.
Sur les plaines d'Abraham, le carnaval propose diverses manifestations. Attrapeur de rêves et tente indienne. On boit la sagamité, un bouillon de maïs avec diverses viandes.
Dès qu’on veut sortir de Québec, la prudence est de mise. Congères accumulées par le vent, routes glacées. Nous avons remis par deux fois un tour en Charlevoix. La troisième est la bonne. Nous passons près de villages dont les rues sont étranglées par des murs de neige de plusieurs mètres. On me raconte l’histoire de cette ménagère qui attendait que la neige arrive aux fenêtres du premier étage pour faire ses vitres à l’extérieur ! La rive du Saint-Laurent est particulièrement désolée. Sortir de la voiture pour prendre quelque photos n’est pas une mince affaire. Il n’est pas conseillé de laisser son vêtement ouvert ou de quitter ses gants.
Je songe aux premiers colons, venus s’installer près du fleuve, dans des coins perdus. J’ai lu sur eux des récits témoignant de la dureté et de la pauvreté de leur vie. Finalement, c’était encore l’hiver qu’on rompait plus facilement l’isolement, car le fleuve gelé ménageait des accès plus aisés qu’en forêt. Vers midi, nous nous trouvons du côté de Baie-Saint-Paul et tombons sur un restaurant-bar dont le nom me fait sourire. Je viens en effet de publier un roman sur le Québec intitulé Cœur de Louve et le bar s’appelle… Cœur de loup ! Surprise en entrant : les serveurs sont vêtus à l’Ecossaise, en kilt. Nous leur en demandons la raison. On nous répond que c’est une initiative destinée à attirer le client. Nous voici donc en train de consommer des produits québécois, servis par des Écossais ! Et moi, je pense à mon héroïne, la fille d’un imprimeur parisien mort sur les barricades de la Commune de Paris et qui vient faire sa vie dans des villages aussi désolés que ceux que nous avons traversés dans la matinée.
La galerie ci-dessous est faite de photos prises au cours des ans, certaines durant le festival d'hiver de Québec, d'autres dans le parc de la Jacques Cartier et du côté de Sainte-Anne.
La photo ci-dessous montre ma conjointe, Hélène, sur le traversier qui relie Québec à Lévis, sur la rive sud. Le Saint-Laurent est tout en glace. Il arrive qu'un traversier, poussé par une plaque de glace, se mette à dériver et qu'on le retrouve du côté de l'île d'Orléans. Juste après cette photo,Hélène m'a dit qu'elle rentrait en cabine, car elle avait trop froid. Comme quoi un bon anorak Garneau et une cagoule de laine intégrale ont difficilement raison du froid québécois ! Hélène a écrit le conte de la luciole pour saluer ses amis québécois.

L'automne
Photos prises dans la Jacques-Cartier, au cap Tourmente, à Lanaudière et en l’un ou l’autre endroit. La plupart témoignent de la saison d’automne, la plus belle avec l’hiver. Le printemps est généralement court et l’été moins attractif pour courir le bois, avec les moustiques, les maringouins et les mouches noires.

féérie

relativement brève

et si fascinante

Les orignaux
Balade le long de la Jacques Cartier, par un matin d’octobre, avec Micheline, l’amie québécoise. Sur la droite, à l’orée du bois, nous voyons de l’herbe foulée et pensons au passage d’un ours. Plus loin, un garde forestier, accroupi, observe la rivière et nous fait signe de nous baisser. Des orignaux sont là, un mâle, deux femelles, deux veaux. C’est la période du rut, nous explique le garde. Les deux femelles sont en conflit, l’une veut chasser l’autre et y réussira. Le mâle n’est pas encore prêt pour un accouplement. Il laisse faire. Nous les observons près d’une heure, en train de patauger dans la rivière, de se défier. Je n’ai pas souvenir de cris. Seulement de forts bruits d’éclaboussements. Ils sortiront de la rivière et passeront à dix mètres de nous.
Ici et là, au gré des flâneries
Regardant mes albums de photos prises au Québec, je me sens proprement in capable de raconter tous ces lieux, ces appartements où j’ai habité, ces maisons où nous accueillaient les amis. Tant de visages ! Il est peu d’endroits que je n’aie visités : je suis allé en Abitibi, au lac Saint-Jean, j’ai participé au salon du livre des villes du Saguenay, et visité les classes d’un collège dédié aux premières nations ; j’ai aimé voir l’Estrie sous les premières neiges d’une campagne encore automnale : je suis allé cueillir des pommes en Beauce où coule la rivière Chaudière,, j’ai dormi chez des amis dans la région de Lanaudière. La Gaspésie est inoubliable, surtout sa côte atlantique où l’on voit les fous de Bassan chers à Anne Hébert et, partant de Percé, les dauphins dignes de ceux du grand Bleu par leurs sauts périlleux et les baleines à bosse qui, mine de rien, vous observent d’un œil curieux en passant près de votre bateau. Je n’ai pas retrouvé mes photos de la Gaspésie. Ci-dessous, j’ai repris (d’où la piètre qualité) des photos de la région de Tadoussac. Nous étions partis des Escoumins en zodiac. Il nous fallut une petite heure d’un trajet sur des vagues rébarbatives, dans la brouillasse, avant d’apercevoir quelques moyens et grands rorquals (une vingtaine de mètres) ainsi que les Belugas, ces petites baleines blanches caractéristiques des lieux, toujours en groupe.
Autre endroit magique du Saint-Laurent, le Cap Tourmente. Superbe endroit pour observer les milliers d’oies des neiges qui y font halte lors de leurs migrations. Un spectacle impressionnant. On peut aussi se promener dans des endroits aménagés pour les marcheurs. Micheline, notre amie québécoise, s’est endormie un jour sur un banc. Au réveil, elle s’est retrouvée devant un ours qui l’observait placidement. Toute petite déjà, elle avait vu un ours venir vers elle, dans son jardin, pendant que son père était parti, fusil à la main, à la recherche de la bête. Elle était vite rentrée se cacher. Micheline, décédée récemment, adorait la nature et les animaux. Elle a écrit un gros livre sur le mode de vie des premières nations : le chamanisme initiatique, enseigné par Aigle bleu.
J’ai beaucoup aimé Charlevoix. Notre amie y avait un chalet familial, tout jaune, au bord du Saint-Laurent. Gabrielle Roy, célèbre écrivaine, vivait tout près, et Micheline se souvient qu’elle allait, toute petite, l’observer en train d’écrire. Micheline s’est mise à écrire, inspirée par ces discrètes observations. Je la vois tout à fait debout près de la porte ouverte, discrète, comme toujours. En Charlevoix, nous avons pris un guide pour aller dans le bois observer les ours. Trois petits espiègles, une mère attentive et un mâle invisible qui remuait un arbre et grognait pour exprimer son mécontentement. La femelle ne lui permettait pas de s’approcher, pour protéger ses petits.
Québec et Montréal
Québec et Montréal sont deux villes d’aspect différent. La première nous rappelle peut-être un peu les villes européennes. La seconde est plus « américaine » avec ses grandes tours. A Québec, un logement situé avenue Wilfrid Laurier, près de l’hôtel Concorde, non loin de la statue de Charles de Gaulle, nous permettait de profiter des plaines d’Abraham où il se passe toujours quelque chose.
À Montréal, nous avons passé tout un automne dans le quartier Jean Talon, non loin du marché, ici photographié au temps d’Halloween. Il y aurait tant à dire sur cette ville séduisante, que je ne saurais à vrai dire pas par quoi commencer. Salons du livre, amis, vie culturelle et universitaire. Alors, quelques photos et passons !